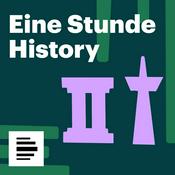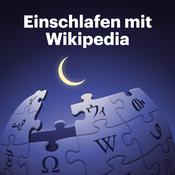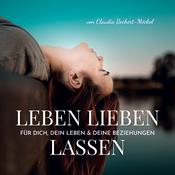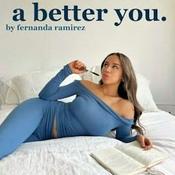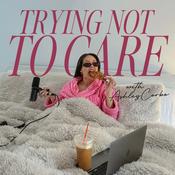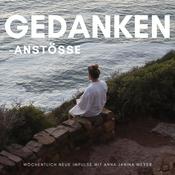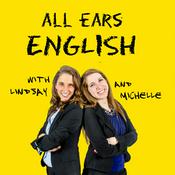3184 Episoden
- L’expression « faire l’autruche » signifie se comporter comme si un danger n’existait pas : refuser de regarder la réalité en face, ignorer un problème, éviter une mauvaise nouvelle. Autrement dit : se cacher pour ne pas affronter.
Mais d’où vient exactement cette formule ? Et pourquoi est-elle injuste envers… la pauvre autruche ?
Une origine ancienne… mais fondée sur une croyance
L’idée que l’autruche se cache en mettant la tête dans le sable circule depuis très longtemps. On la trouve déjà dans l’Antiquité, puis au Moyen Âge : les auteurs de bestiaires décrivent l’autruche comme un animal un peu “bête”, ou du moins étrange, capable de comportements absurdes. L’image est ensuite devenue un symbole moral : l’autruche serait celle qui refuse de voir le danger, et cette métaphore a fini par s’imposer dans la langue.
Pourquoi cette croyance a-t-elle été si tenace ? Parce qu’elle est visuellement parfaite : on imagine très bien un oiseau immense, dépassé par la situation, qui se protège en cachant sa tête. C’est absurde, donc mémorable. Et surtout, ça fonctionne merveilleusement comme leçon de vie : “n’ignore pas les problèmes”.
Pourquoi c’est complètement faux
En réalité, l’autruche ne met pas sa tête dans le sable pour se cacher. C’est même l’inverse : elle est plutôt prudente et vigilante.
Si ce mythe existe, c’est à cause de plusieurs comportements réels mais mal interprétés :
1. Elle baisse la tête au sol
L’autruche passe beaucoup de temps à chercher de la nourriture. Elle picore, fouille, examine le sol. De loin, sa longue tête au ras du terrain peut donner l’impression qu’elle “disparaît” dans le sable.
2. Elle s’occupe de ses œufs
Autre point clé : l’autruche creuse un nid peu profond dans le sol. Elle y pond, puis elle tourne les œufs, les réarrange, parfois le bec près du sable. Là encore, vu de loin, on peut croire qu’elle “enterre” la tête.
3. Elle se couche pour se camoufler
Quand elle se sent menacée, il lui arrive de s’aplatir au sol, cou tendu. Dans la savane, cette posture peut la rendre moins visible. Mais ce n’est pas du déni : c’est une stratégie de survie.
Et si la menace devient sérieuse, l’autruche ne se cache pas : elle fuit — très vite — ou elle se défend avec des coups de pattes redoutables.
Conclusion : dire d’une personne qu’elle “fait l’autruche”, c’est l’accuser d’être lâche et aveugle… alors que l’autruche, elle, est tout sauf stupide. Elle observe, elle s’adapte, et elle agit.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations. - Hanford, c’est l’histoire d’un endroit choisi pour sauver une guerre… et qui est devenu, ensuite, l’un des héritages radioactifs les plus lourds de la planète.
Nous sommes en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis lancent le projet Manhattan, la course secrète à la bombe atomique. Pour fabriquer une bombe, il faut une matière nouvelle : le plutonium. Et pour produire du plutonium en grande quantité, il faut des réacteurs nucléaires, des usines chimiques, une logistique immense… et surtout un lieu discret.
C’est ainsi qu’est sélectionné un vaste territoire au bord du fleuve Columbia, dans l’État de Washington : Hanford. Le site est idéal pour plusieurs raisons : il est éloigné des grandes villes, dispose d’une abondante eau froide pour refroidir les réacteurs, bénéficie d’hydroélectricité bon marché, et d’infrastructures de transport. Tout cela en fait une usine nucléaire parfaite… et profondément secrète.
À Hanford, on construit à une vitesse folle. Le premier réacteur, le B Reactor, démarre en 1944. Le plutonium produit ici sera utilisé pour la première bombe testée au Nouveau-Mexique, puis pour la bombe larguée sur Nagasaki en 1945.
Mais l’histoire ne s’arrête pas à la victoire. Avec la Guerre froide, Hanford devient une machine industrielle colossale : jusqu’à neuf réacteurs et plusieurs complexes de retraitement. Pendant des décennies, le site fournit l’essentiel du plutonium de l’arsenal nucléaire américain.
Le problème, c’est que tout cela produit des déchets… et à l’époque, la priorité n’est pas l’environnement. Les procédures de sûreté sont insuffisantes, et une partie des rejets radioactifs finit dans l’air et dans le fleuve. Les déchets les plus dangereux sont stockés dans 177 cuves souterraines, dont certaines ont fui. Aujourd’hui encore, Hanford contient environ 56 millions de gallons de déchets radioactifs, ce qui en fait l’un des sites les plus contaminés des États-Unis.
Depuis la fin de la production, Hanford est devenu le symbole du “prix caché” de l’ère nucléaire : un chantier de nettoyage titanesque, coûteux (on parle de 60 milliards de dollrs), technique, et interminable. Une partie du plan consiste désormais à transformer ces déchets en verre (vitrification) pour les stabiliser.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations. - Chaque 1er janvier, on se promet de faire du sport, de manger mieux, d’arrêter de scroller la nuit… Et on croit que c’est une lubie moderne. Pourtant, selon une idée largement relayée par les historiens des traditions, le fait de prendre des “bonnes résolutions” remonterait à plus de 4 000 ans, chez les Babyloniens. Alors : mythe ou réalité ?
Réponse : c’est vrai dans l’esprit… mais pas dans la forme.
Dans la Mésopotamie antique, vers 2000 avant notre ère, les Babyloniens célèbrent le Nouvel An lors d’un grand festival de douze jours appelé Akitu. Ce n’est pas en janvier : c’est au printemps, au moment où l’on relance le cycle agricole. Mais c’est bien un moment symbolique de “redémarrage” : la société entière se remet en ordre, on renouvelle les pouvoirs, on réaffirme des équilibres.
Et au cœur de cette fête, il y a une pratique très proche de nos résolutions : les Babyloniens faisaient des promesses aux dieux. Ils s’engageaient notamment à rembourser leurs dettes et à rendre les objets empruntés. Ces engagements n’étaient pas de simples intentions, mais de véritables vœux religieux, liés à une croyance : si l’on respecte sa parole, les dieux accorderont leur faveur pour l’année à venir. Cette filiation est souvent présentée comme l’ancêtre de nos résolutions modernes.
Donc oui : l’idée de “commencer l’année par une promesse de mieux faire” existait déjà.
Mais attention : ces promesses babyloniennes n’étaient pas des objectifs de développement personnel. On ne se disait pas “je vais devenir la meilleure version de moi-même”. L’enjeu était surtout moral et social : honorer ses obligations, rétablir l’ordre, rester dans les bonnes grâces du divin.
Au fil des siècles, l’idée a survécu et s’est transformée. Les Romains, par exemple, faisaient des promesses au dieu Janus. Puis la tradition s’est progressivement sécularisée : au lieu de promettre aux dieux, on se promet à soi-même.
Conclusion : oui, prendre de bonnes résolutions a bien plus de 4 000 ans. Mais nos résolutions actuelles sont une version très moderne d’un vieux réflexe humain : profiter du passage à une nouvelle année pour se réinventer… et croire qu’on va enfin s’y tenir.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations. - Le principe de réfutabilité est l’une des idées les plus célèbres — et les plus mal comprises — de la philosophie des sciences. Il a été formulé au XXᵉ siècle par le philosophe Karl Popper, avec une ambition claire : définir ce qui distingue une théorie scientifique d’un discours qui ne l’est pas.
À première vue, la science semble reposer sur la preuve. On pourrait croire qu’une théorie est scientifique parce qu’elle est confirmée par des expériences. Or, Popper renverse totalement cette intuition. Selon lui, aucune théorie scientifique ne peut jamais être définitivement prouvée vraie. Pourquoi ? Parce qu’une infinité d’observations positives ne garantit jamais que la prochaine ne viendra pas la contredire. En revanche, une seule observation contraire suffit à invalider une théorie.
C’est là qu’intervient le principe de réfutabilité. Pour Popper, une théorie est scientifique si et seulement si elle peut, en principe, être réfutée par les faits. Autrement dit, elle doit faire des prédictions suffisamment précises pour qu’on puisse imaginer une expérience ou une observation qui la rende fausse. Si aucune observation possible ne peut la contredire, alors elle sort du champ de la science.
Un exemple classique permet de comprendre. L’énoncé « tous les cygnes sont blancs » est réfutable : il suffit d’observer un seul cygne noir pour le contredire. À l’inverse, une affirmation comme « des forces invisibles et indétectables influencent secrètement le monde » n’est pas réfutable, puisqu’aucune observation ne peut la mettre en défaut. Elle peut être intéressante sur le plan philosophique ou symbolique, mais elle n’est pas scientifique.
Popper utilise ce critère pour critiquer certaines théories très populaires à son époque, comme la psychanalyse ou certaines formes de marxisme. Selon lui, ces systèmes expliquent tout a posteriori, mais ne prennent jamais le risque d’être démentis par les faits. Quand une prédiction échoue, l’explication est ajustée, ce qui rend la théorie indestructible… et donc non scientifique.
Ce point est fondamental : pour Popper, la science progresse par erreurs corrigées, non par accumulation de certitudes. Une bonne théorie n’est pas celle qui se protège contre la critique, mais celle qui s’expose volontairement à la possibilité d’être fausse. Plus une théorie est risquée, plus elle est scientifique.
Aujourd’hui encore, le principe de réfutabilité structure la méthode scientifique moderne. Il rappelle que la science n’est pas un ensemble de vérités absolues, mais un processus critique permanent. Une théorie n’est jamais vraie pour toujours ; elle est simplement la meilleure disponible, tant qu’elle résiste aux tentatives de réfutation.
En résumé, le principe de réfutabilité de Popper nous apprend une chose essentielle : en science, le doute n’est pas une faiblesse, c’est une condition de progrès.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations. - Dans l’imaginaire collectif, le bouffon de cour est presque toujours un homme. Pourtant, les archives montrent que des femmes occupaient aussi ce rôle, en particulier dans les cours princières et royales d’Europe. Elles étaient plus rares, mais pas exceptionnelles.
Comme leurs homologues masculins, les bouffonnes pouvaient être :
des artistes comiques,
des musiciennes ou chanteuses,
des conteuses,
ou des personnes présentant une singularité physique ou mentale, ce qui correspond malheureusement aux normes de l’époque.
Elles remplissaient les mêmes fonctions essentielles : divertir, désamorcer les tensions, parfois dire des vérités qu’aucun courtisan n’osait formuler.
Le cas emblématique de Jane Foole
La plus célèbre d’entre elles est Jane Foole, active au début du XVIᵉ siècle en Angleterre. Elle servit successivement Henri VIII et surtout sa fille Marie Ire d’Angleterre, dite « Bloody Mary ».
Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, Foole n’était pas forcément son nom de naissance, mais une désignation liée à sa fonction. Jane apparaît régulièrement dans les comptes royaux : elle recevait un salaire, des vêtements, parfois même des cadeaux, preuve qu’elle occupait une place reconnue à la cour.
Les sources suggèrent qu’elle était probablement atteinte d’un handicap mental, ce qui, dans la logique cruelle de l’époque, faisait partie de sa “fonction”. Mais réduire Jane Foole à cela serait une erreur. Sa longévité à la cour — plusieurs décennies — indique qu’elle était appréciée, protégée et intégrée, notamment par Marie Tudor, qui semblait très attachée à elle.
La présence de bouffonnes est d’autant plus intéressante qu’elles combinaient deux marginalités : être femme dans un monde politique dominé par les hommes, et être bouffon, donc hors des hiérarchies sociales classiques. Cela leur donnait parfois une liberté de parole encore plus singulière.
Mais cette même marginalité explique aussi pourquoi elles ont été moins bien documentées. L’histoire officielle, écrite par des hommes, a largement ignoré ces figures jugées secondaires.
Oui, il y eut des bouffonnes au Moyen Âge et à la Renaissance. Jane Foole en est la preuve la plus solide : une femme, salariée de la cour d’Angleterre, occupant un rôle central dans la vie quotidienne des souverains. Son histoire rappelle que le rire, la transgression et la parole libre n’étaient pas réservés aux hommes — même si la mémoire historique, elle, l’a longtemps fait croire.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Weitere Bildung Podcasts
Trending Bildung Podcasts
Über Choses à Savoir - Culture générale
Développez votre culture générale. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
Podcast-WebsiteHöre Choses à Savoir - Culture générale, Quarks Science Cops und viele andere Podcasts aus aller Welt mit der radio.de-App
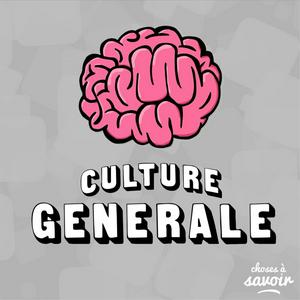
Hol dir die kostenlose radio.de App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen
Hol dir die kostenlose radio.de App
- Sender und Podcasts favorisieren
- Streamen via Wifi oder Bluetooth
- Unterstützt Carplay & Android Auto
- viele weitere App Funktionen

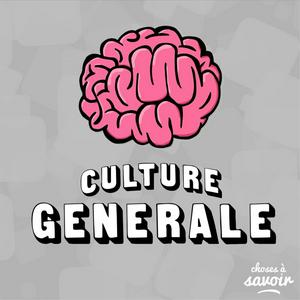
Choses à Savoir - Culture générale
Code scannen,
App laden,
loshören.
App laden,
loshören.